|
SpaceNews
dans l'immensité de
l'univers

©
Kagaya
les galaxies -
la voie lactée
-
énergie sombre -
les étoiles
les
astéroïdes -
interrogations &
recherches
les galaxies
 03.03.2005 Découverte
d’un amas de galaxies de 11 milliards d’années
03.03.2005 Découverte
d’un amas de galaxies de 11 milliards d’années
 |
Cet amas aurait au moins 11 milliards d’années, alors que l’univers
lui-même a environ 14 milliards d’années.
Bien qu’il appartienne à un univers très jeune, cet amas présentent les
caractères de la maturité, qu’il s’agisse de la couleur rouge de ses
galaxies de type elliptique, des étoiles anciennes qu’elles contiennent
ou de la forme sphérique de l’amas. Il ressemble à des amas beaucoup
plus récents.
Les astrophysiciens ne s’attendaient pas à trouver ce type d’objet dans
un univers aussi lointain. Les travaux de cette équipe pourraient
permettre de découvrir d’autres amas du même type.
Mullis et ses
collègues de l’ESO ont commencé par fouiller les archives de
l’observatoire spatial XMM-Newton, à la recherche de nouvelles sources
de rayons X. |
|
Ils ont ainsi repéré la présence de cet amas dans l’univers lointain et
ont utilisé le Very Large Telescope (VLT) de l’ESO, installé
au Chili, pour l’observer.
Les chercheurs ont l’intention de poursuivre leurs investigations en
suivant la même méthode pour découvrir d’autres objets massifs très
éloignés. Ces travaux seront publiés prochainement dans The
Astrophysical Journal.
(NOUVELOBS.COM) |
 16.02.2004 découverte d' une
lointaine galaxie
16.02.2004 découverte d' une
lointaine galaxie
|
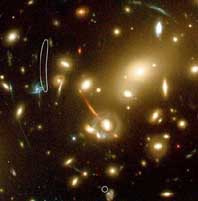
|
Les
âges sombres correspondent
au premier milliard d'années après le Big Bang, une période mal connue,
pendant laquelle l'Univers n'aurait été qu'un mélange de matière sombre et
de gaz, précédant la formation des étoiles. Les
astronomes tentent de comprendre
les événements cosmiques qui ont provoqué la fin des âges sombres et le
début de la formation des étoiles, planètes et systèmes stellaires tels
qu'ils existent aujourd'hui.
Une
équipe internationale d'astronomes a pu observer la galaxie la plus distante
jamais identifiée, dont la lumière reçue sur Terre à été émise quand
l'Univers était dans sa prime jeunesse.
Les images de cette galaxie ont été perçues grâce au télescope spatial
Hubble et confirmée par l'observatoire Keck à Hawaï. La
lumière perçue de cette galaxie a été émise alors que cette dernière n'était
âgée que de 750 millions d'années et elle a mis plus de 13 milliards d'années-lumière
à parvenir jusqu'à la Terre, selon les chercheurs. |
|
"Les
caractéristiques inhabituelles de cette source éloignée sont fascinantes car
elles pourraient représenter celles de jeunes systèmes stellaires à la fin
des âges
sombres",
a estimé M. Ellis.
|
 09.01.2008 Ancêtres
galactiques
09.01.2008 Ancêtres
galactiques
|
Comment et combien de temps après le Big-Bang se sont formées les
premières galaxies ?... Même si les astronomes disposent de quelques
éléments de réponse, ils étudient toujours la question. Les dernières
découvertes et observations démontrent l’existence d’amas galactiques
environ un milliard d’années après le Big-Bang. Ces toute jeunes
structures, appelées protogalaxies, étaient petites ; relativement
sombres et émettaient essentiellement des infrarouges. |
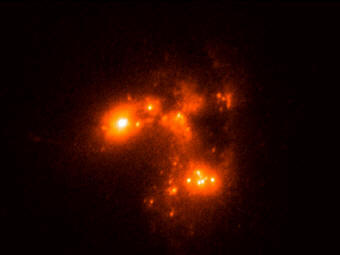 |
C’est en entrant en collision et en fusionnant qu’elles ont pu croître
pour donner les galaxies observables aujourd’hui. Les astronomes
cherchent maintenant à déterminer, parmi la grande variété d’amas
observés, ceux qui ont évolué en forme de galaxies spiralées et ceux qui
ont grandi sous forme de galaxies elliptiques géantes. En observant,
grâce au télescope Hubble, l’Univers tel qu’il était il y a douze
milliards d’année, une équipe d’astronomes pense avoir découvert les
ancêtres des galaxies en spirales.
Ces objets dix fois plus petits et 20 à 40 fois moins massif que la Voie
Lactée sont connus sous le nom d’émetteurs Lyman alpha. La lumière émise
par ces amas d’étoiles et la façon dont ils sont regroupés dans l'espace
indique qu'ils doivent avoir été les pierres angulaires des grandes
galaxies comme la Voie Lactée. |
|
Pour autant toutes les grandes galaxies ne sont pas le résultat de
fusions. En effet, Hubble a détecté de telles galaxies dans l’Univers
primordial et selon les astrophysiciens le temps manque pour expliquer
leur naissance par collisions. Elles sont probablement apparues d’un
coup suite à l’effondrement brutal de très vastes nuages de gaz.
(nouvelobs.com) |
 28.09.2005 Découverte
d'une galaxie 8 fois plus massive que la Voie Lactée 28.09.2005 Découverte
d'une galaxie 8 fois plus massive que la Voie Lactée
|
Des astronomes américains ont annoncé la découverte d'une galaxie née
dans l'enfance de l'Univers, 8 fois plus massive que la Voie Lactée. La
masse importante et la maturité de cette galaxie baptisée HUDF-JD2 au
moment où l'Univers --dont l'âge est estimé à 13,5 milliards d'années-- n'avait que 800
millions d'années, a surpris la communauté astronomique.
"Nous avons trouvé cette galaxie aux distances les plus éloignées, là où les
autres galaxies déjà découvertes sont jeunes et petites", a expliqué Bahram
Mobasher, du "Space Telescope Science Institute". "Mais au lieu de cela
nous avons vu des indications que cette galaxie est remarquablement développée
et beaucoup plus massive, ce qui est une grande surprise", a-t-il ajouté.
|
 |
|
Jusque là, les scientifiques
estimaient que les premières galaxies formées dans les débuts de l'univers
contenaient beaucoup moins d'étoiles que celles créées plus tard, comme la
Voie Lactée où se situe notre système solaire. Cette découverte tend à
indiquer que la grande partie de la formation des galaxies s'est produite
beaucoup plus tôt. "Si la mesure de la distance de cet objet est confirmée,
cela indiquera que l'activité galactique était beaucoup plus intense dans une
période encore plus reculée de l'histoire de l'Univers", a expliqué Richard Ellis. "C'est comme si en traversant l'océan on rencontrait une mouette qui
signale que la terre est proche", a-t-il dit. "La découverte de cette galaxie
nous donne de bonnes raisons de chercher au-delà vers l'aube cosmique quand la
première galaxie est née", a ajouté l'astronome. Cette galaxie a été
découverte parmi environ 10.000 autres dans un petit coin du ciel appelé le
"Champ ultra profond de Hubble"
(AfP)
|
 07.06.2005 La
galaxie d'Andromède est trois fois plus grande qu'on ne le croyait
07.06.2005 La
galaxie d'Andromède est trois fois plus grande qu'on ne le croyait
|
Des astronomes des Etats-Unis et de la France ont observé le mouvement
de certaines des étoiles de la périphérie de la galaxie d'Andromède
(M31), et ont constaté qu'elles font en réalité partie de son disque
principal. Cette découverte n'avait pas été faite jusqu'à présent parce
que la détection du mouvement de ces étoiles exige des observations très
précises. |
|
La nouvelle mesure est basée sur les mouvements d'environ 3.000 étoiles
se situant à une certaine distance du disque, dans ce qui n'était
jusqu'à présent que le "halo" de la galaxie. En effectuant des mesures
très précises "des vitesses radiales", les chercheurs ont pu déterminer
finement comment chaque étoile se déplace par rapport à la galaxie.
Les résultats ont prouvé que les étoiles périphériques se situent dans
le plan du disque lui-même et qu'elles se déplacent à des vitesses
prouvant qu'elles sont en orbite autour du centre de la galaxie.
Essentiellement, cela signifie que le disque est beaucoup plus grand
qu'on ne le pensait. De plus, les chercheurs ont déterminé que la
rotation non homogène du disque, représentée par les franges externes
massives et bulbeuses, montre qu'Andromède doit être le résultat de
galaxies satellites qui se sont enchevêtrées il y a fort longtemps. Si
ce n'était pas le cas, les étoiles seraient plus régulièrement espacées.
WASHINGTON
(AP) |

|
 20.09.2006 I0K-1:
découverte d'une ancienne galaxie 20.09.2006 I0K-1:
découverte d'une ancienne galaxie
|
 Avec le télescope Subaru de 8,2 mètres installé sur l'archipel d'Hawaii,
des astronomes japonais ont regardé 60 millions d'années plus loin dans le
temps que la plus reculée des observations précédentes pour trouver la
plus lointaine galaxie connue de l'Univers. Cette dernière découverte est
une galaxie appelée I0K-1 qui se trouve à 12,88 milliards d'années
lumière, c'est-à-dire qu'elle apparaît telle qu'elle était il y a 12,88
milliards d'années, hormis son apparence rouge causée par l'expansion de
l'Univers. C'est par ailleurs ce décalage vers le rouge (redshift 6.964)
qui a permis de confirmer l'age de l'objet. Avec le télescope Subaru de 8,2 mètres installé sur l'archipel d'Hawaii,
des astronomes japonais ont regardé 60 millions d'années plus loin dans le
temps que la plus reculée des observations précédentes pour trouver la
plus lointaine galaxie connue de l'Univers. Cette dernière découverte est
une galaxie appelée I0K-1 qui se trouve à 12,88 milliards d'années
lumière, c'est-à-dire qu'elle apparaît telle qu'elle était il y a 12,88
milliards d'années, hormis son apparence rouge causée par l'expansion de
l'Univers. C'est par ailleurs ce décalage vers le rouge (redshift 6.964)
qui a permis de confirmer l'age de l'objet.
Cette découverte, basée sur les observations faites par Masanori Iye
(National Astronomical Observatory of Japan), de Kazuaki Ota (University
of Tokyo), de Nobunari Kashikawa (NAOJ), et d'autres, indique que des
galaxies existaient seulement 780 millions d'années après la naissance de
l'Univers, survenue il y a environ 13,66 milliards d'années.
(National Astronomical Observatory of Japan) |
 02.03.2007
Détection d'une galaxie en pleine
transformation 02.03.2007
Détection d'une galaxie en pleine
transformation
|
Une équipe internationale de scientifiques dont un chercheur du
Laboratoire d'astrophysique de Marseille vient de détecter une galaxie
en train de se faire "dénuder" de son gaz et de ses étoiles, surnommée
"la galaxie-comète", a annoncé vendredi l'Observatoire astronomique de
Marseille-Provence. "L'étude
de cette galaxie, effectuée à partir
d'observations réalisées avec le télescope Hubble et une kyrielle
d'autres télescopes et satellites,
apporte un nouvel éclairage sur le mystérieux
et long mécanisme de transformation des galaxies au sein des amas de
galaxies", selon le communiqué. Elle "pourrait permettre d'expliquer le
processus de formation des millions d'étoiles isolées au centre des
amas".
 L'équipe
qui a réalisé cette découverte a étudié l'amas de galaxies Abell 2667 pour réaliser ses observations
sur cette "galaxie-comète", ainsi nommée en raison de la traînée de gaz
et d'étoiles dans son sillage.
"Au cours de ce formidable plongeon au cœur d'Abell 2667, les étoiles et
le gaz de cette galaxie sont littéralement éjectés, donnant naissance à
une longue traînée de nuages de gaz bleu lumineux et de jeunes étoiles,
ressemblant à une queue de comète", explique Jean-Paul Kneib. L'équipe
qui a réalisé cette découverte a étudié l'amas de galaxies Abell 2667 pour réaliser ses observations
sur cette "galaxie-comète", ainsi nommée en raison de la traînée de gaz
et d'étoiles dans son sillage.
"Au cours de ce formidable plongeon au cœur d'Abell 2667, les étoiles et
le gaz de cette galaxie sont littéralement éjectés, donnant naissance à
une longue traînée de nuages de gaz bleu lumineux et de jeunes étoiles,
ressemblant à une queue de comète", explique Jean-Paul Kneib.
"Avec la galaxie
comète, nous obtenons pour la première fois une information sur une des
premières étapes de ce processus de transformation qui ne dure
probablement que quelques centaines de millions d'années, étape au cours
de laquelle une importante formation d'étoiles est déclenchée", selon le
texte.
(Marseille -
afp) |
 30.10.2007 ballet
stellaire
30.10.2007 ballet
stellaire
|
Arp 87 est une paire de galaxies découverte dans les années 70 par
l’astronome Halton Arp. Située dans la constellation du Lion, à environ
300 millions d’années lumière de la Terre, elle se compose de deux
galaxies en spirale : NG3808, la plus grande (à droite sur la photo) et
sa compagne NG3808A, à gauche.
NG3808 a été photographié pratiquement de
face et les images ont révélé à sa périphérie un anneau brillant composé
d’étoiles en formation ainsi que plusieurs bras, assez proéminents, de
poussières. Son vis à vis est plus petit est entouré d’un anneau en
rotation contenant des étoiles et de grande quantité de gaz
interstellaire. |
 |
|
Entre les deux galaxies, il existe une sorte de pont ou de chenal
composé de matériel stellaire qui suggère qu’une partie des étoiles de
la lus grande galaxie converge vers la plus petite. En tout cas, cette
interaction a modifié la forme des deux structures. Ce type de galaxies,
en train de fusionner, présente souvent des taux de formations d’étoiles
largement supérieur à la normale et constitue de véritables berceaux de
soleils. Plusieurs données confirment cet état : la couleur des étoiles,
l’intensité des émissions issues des gaz interstellaires ainsi que la
radiation infrarouge de la poussière interstellaire.
Les images d’Hubble révèlent également la présence de nombreux super
amas contenant beaucoup d’étoiles jeunes regroupées dans un petit
volume. Ces structures sont normalement très rares dans notre voisinage
galactique et se retrouvent plutôt dans des galaxies très éloignées.
(nouvelobs.com) |
 11.04.2007 La
galaxie aux bras fantômes
11.04.2007 La
galaxie aux bras fantômes
|
En croisant les données issues de 4 systèmes d’observations différents,
les astronomes ont pu élucider un mystère qui les perturbe depuis près
de quarante cinq ans : deux énigmatiques bras en spirales autour de la
galaxie M106 qui n’apparaissent que sur les images aux rayons X. M106
(également connu sous le nom de NGC 4258) est une galaxie en spirale
située à une distance de 23.5 millions d'années-lumière du système
solaire, dans la constellation des chiens de chasse, elle a un diamètre
de 30 000 années-lumière environ.
|
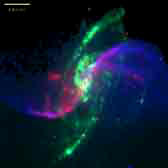 |
Les observations dans le spectre de la lumière visible de cette galaxie
montrent 2 bras émanant du noyau et s’enroulant en spirale à
l’extérieur. Ils sont délimités notamment par des régions d'intense
activité de formation stellaire, où l'on peut apercevoir de nombreuses
étoiles bleues, très jeunes et très chaudes, et des nuages de gaz
ionisé, de couleur rouge.
Jusqu’ici rien de très anormal, pourtant sur les images aux rayons X et
sur les observations radios il apparait 2 bras additionnels qui dominent
l’image entre les 2 bras principaux. Les astronomes ont longtemps cru
qu’ils représentaient un jet de particules issues d’un trou noir super
massif situé au cœur de la galaxie mais cette hypothèse a été abandonnée
suite à l’observation d’une autre émission provenant du noyau. |
|
Cette découverte a encore un peu plus brouillé les pistes et il a fallu
attendre 2001 pour avoir une nouvelle hypothèse. Cette fois les
chercheurs ont supposé qu’il y avait quand même un lien entre les bras
fantômes et les 2 jets émis par le trou noir du noyau. En effet, si on
pouvait les mettre sur le même plan, ils s’aligneraient parfaitement.
D’où la nouvelle supposition selon laquelle les deux bras fantômes
représentent un rayonnement provenant des gaz fortement chauffés par le
passage du jet de particules. En utilisant les images des observatoires
Spitzer et Chandra de la NASA, du satellite à rayons X Newton de l’ESA
et des images d’archives prises par le télescope Hubble, les astronomes
ont enfin pu confirmer cette dernière hypothèse : les bras fantôme sont
bien issus d’un rayonnement de gaz chauffé à plusieurs millions de
degrés par des particules projetés d’un trou noir situé au centre de la
galaxie.
(Sciences et
Avenir.com) |
 30.05.2007 Dans
les bras de la galaxie M81
30.05.2007 Dans
les bras de la galaxie M81
|
 L'image
la plus précise jamais obtenue de la galaxie M81 a été dévoilée cette
semaine au congrès de la Société américaine d’astronomie (AAS), à
Honolulu (Hawaii). Elle a été composée à partir de clichés pris par le
télescope spatial Hubble en 2004 et 2006 grâce à son instrument phare,
l’ACS (Advanced Camera for Surveys), qui a depuis souffert de plusieurs
pannes. L'image
la plus précise jamais obtenue de la galaxie M81 a été dévoilée cette
semaine au congrès de la Société américaine d’astronomie (AAS), à
Honolulu (Hawaii). Elle a été composée à partir de clichés pris par le
télescope spatial Hubble en 2004 et 2006 grâce à son instrument phare,
l’ACS (Advanced Camera for Surveys), qui a depuis souffert de plusieurs
pannes.
La galaxie spirale M81 est située à 11,6 millions d’années lumière dans
la constellation de la Grande Ourse. L’image obtenue avec Hubble permet
aux astronomes d’observer une seule étoile au milieu d’un amas ouvert ou
d’un amas globulaire très dense.
Les bras de la galaxie abritent des étoiles jeunes et très chaudes
(bleues) formées au cours du million d’années écoulées ainsi que des
étoiles issues d’un précédent épisode de formation stellaire, il y a 600
millions d ‘années, précisent les astronomes. Le bulbe central de la
galaxie contient les plus vieilles étoiles. En son cœur réside un trou
noir quinze fois plus massif que celui de la Voie lactée et qui équivaut
à 70 millions de fois la masse du Soleil.
(Sciences et
Avenir.com) |
la
voie lactée
 10.01.2006 La
Voie Lactée, gigantesque disque voilé vibrant comme un tambour 10.01.2006 La
Voie Lactée, gigantesque disque voilé vibrant comme un tambour
|
La Voie Lactée est un gigantesque disque gazeux voilé vibrant comme un
tambour, qui tiendrait ces caractéristiques de deux autres galaxies voisines,
dites Nuages de Magellan, qui provoqueraient des vagues intergalactiques, ont
expliqué des astrophysiciens. |
|

Nuages de Magellan |
Pour tenter de déterminer la cause du voilage de notre galaxie, observé par
les scientifiques depuis un demi-siècle, Léo Blitz, professeur d'astronomie à
l'université de Berkeley et d'autres astronomes, ont analysé les émissions de
gaz d'hydrogène dans la zone de déformation qui s'étend sur toute la longueur
du diamètre de 200.000 années-lumière du disque galactique. Ces analyses ont
mis en évidence le fait que, non seulement la Voie Lactée se déformait, mais
qu'elle vibrait comme une peau de tambour.
Ces vibrations suivent 3 modes distincts correspondant à 3 déformations
différentes. La 1ère fait ressembler la Voie Lactée à un chapeau mou avec le
bord abaissé à l'avant et relevé à l'arrière. La 2nde rappelle une cuvette et
la 3ème forme serait plutôt celle d'une selle de cheval. Or, il y a une
étroite corrélation entre ces 3 modes de vibrations et de déformations et les
orbites des 2 petites galaxies voisines, qui forment les Nuages de Magellan.
En s'approchant de notre galaxie, les Nuages de Magellan traversent un halo de
matière dite sombre, qui entoure la Voie Lactée, y provoquent des remous, qui
causent des vibrations et la déformation de notre disque galactique. |
|
Cette matière invisible constituerait jusqu'à 90% de la matière dans
l'univers. Jusqu'ici, l'influence des 2 galaxies des Nuages de Magellan avait
été écartée en raison de leur masse beaucoup plus faible que celle de la Voie
Lactée, autour de laquelle elles effectuent une révolution en 1,5 milliard
d'années. Le soleil et la Terre, qui se trouve dans la partie intérieure de la
Voie Lactée, relativement proche du centre de la galaxie où se trouve un
gigantesque trou noir, ne sont pas affectés par cette déformation.
Des astronomes américains ont par ailleurs annoncé la découverte d'un énorme
groupe d'étoiles aux confins de la Voie Lactée. Cette amas stellaire a une
masse d'environ vingt fois plus grande que celles des autres groupes d'étoiles
connus dans la Voie Lactée, ont-ils expliqué lors d'une conférence de presse
en marge de la 207e conférence de l'American Astronomical Society.
(AFP)
|
 16.04.2004 Une
vue de la Voie lactée
16.04.2004 Une
vue de la Voie lactée
|
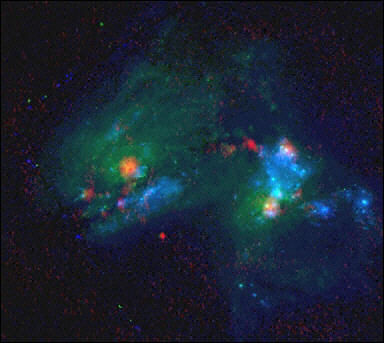
|
Des astronomes ont pu repérer une planète tournant autour d'une
étoile dans la Voie lactée en utilisant pour la première fois un effet
naturel de loupe cosmique.(...) Le physicien américain d'origine
allemande Albert Einstein avait été le premier à décrire cet effet de
loupe dans sa Théorie de la relativité générale. "
La
vrai force de la microlentille gravitationnelle est sa capacité à détecter
des planètes de faible masse",
a expliqué Ian Bond, de l'Institut d'Astronomie d'Édimbourg (Écosse).
La
nouvelle planète observée est en orbite autour d'une étoile située
à 17.000 années lumière de la Terre, dans la constellation du
Sagittaire. Cette planète est probablement une fois et demi plus grosse
que Jupiter, et trois fois plus éloignée de nous que la distance de la
Terre au Soleil. Ce
procéder devrait permettre de repérer d'autres planètes de la taille
de Neptune ou même de la Terre, autour d'étoiles très éloignées.
(AFP) |
 18.02.2005 Une
bouffée d'énergie d'une puissance inédite observée dans la Voie lactée 18.02.2005 Une
bouffée d'énergie d'une puissance inédite observée dans la Voie lactée
|
Une brève "bouffée" de rayonnements de très haute énergie de
rayonnements gamma, puis de rayonnements X d'une puissance jamais vue
jusqu'ici, a été détectée dans la Voie lactée le 27 décembre. L'énergie
produite en deux centièmes de secondes lors de cet éclair a été
supérieure à ce que le Soleil a produit en 250.000 ans.
|
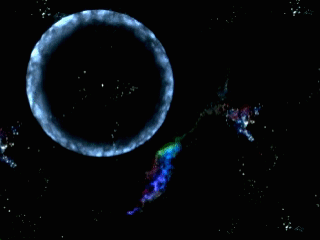 |
Cette bouffée d'énergie mille fois plus importante que les plus
brillantes supernovae (explosions d'étoiles massives) provient d'un sursauteur gamma connu,
SGR 1806-20 (SGR pour "Soft Gamma Ray").
SGR 1806-20 se trouve dans la constellation du Sagittaire, à 50.000
années-lumière. Selon certains chercheurs américains qui ont analysé
l'émission radio de son "flash", il ne se serait toutefois qu'à 30.000
années-lumière.
Les sursauteurs gamma mous sont des étoiles à neutrons - des résidus
d'étoiles d'une masse supérieure à une fois et demie celle du Soleil,
qui ont explosé en supernovae - émettant à intervalles plus ou moins
réguliers de brèves et intenses bouffées de rayonnement gamma de basse
énergie.
|
|
Lors de leur naissance, certaines de ces étoiles à neutrons, en raison
de leur grande vitesse de rotation, engendreraient un puissant champ
magnétique (de l'ordre de 800 millions de millions de gauss, alors que
le champ magnétique terrestre est de moins de un gauss et celui du
Soleil de 10 G).
(AFP) |
 07.07.2005 Un
nouveau type de source gamma découvert dans la Voie lactée 07.07.2005 Un
nouveau type de source gamma découvert dans la Voie lactée
|
Des astrophysiciens de la collaboration internationale Hess (High
Energy Stereoscopic System), qui réunit notamment des laboratoires
du CNRS et du CEA, ont découvert un type nouveau et inattendu de source
de rayons gamma de haute énergie. Il s'agit d'un système binaire composé
d'une étoile normale et d'un objet plus compact (un trou noir ou une
étoile à neutrons). Les rayons gamma sont produits dans des
accélérateurs de particules cosmiques, comme les supernovae. |
|
 |
Ils nous renseignent sur les phénomènes de haute énergie à l'œuvre dans
la Voie Lactée. Le réseau de télescopes Hess réalise le premier balayage
de notre galaxie dans ce domaine d'énergie, découvrant ainsi de
nombreuses sources encore inconnues.
Les astrophysiciens de la collaboration Hess ont découvert un nouveau
type de source gamma de haute énergie. C'est un système composé de deux
objets en orbite l'un autour de l'autre. Le premier est une étoile
normale, tandis que le second est un trou noir ou une étoile à neutrons
(une étoile en fin de vie, après le stade de la supernova), beaucoup
plus compact que son compagnon, dont il attire la matière. |
|
Cette matière tombe vers l'objet compact en décrivant une spirale, un
peu comme l'eau qui se vide dans un évier. Le trou noir ou l'étoile à
neutron expulse un jet de matière se déplaçant à 20 % de la vitesse de
la lumière et qui produit les rayons gamma détectés avec Hess.
Jusqu'à présent, on connaissait une dizaine d'exemples de tels systèmes
binaires dans notre galaxie, mais qui émettaient dans un domaine
d'énergie moins élevé (celui des ondes radio et des rayons X). C'est
l'un d'eux qui vient d'être identifié comme une source gamma.
Deux questions demeurent en suspens : pourquoi le
jet de matière de la nouvelle source ne se déplace-t-il pas à une
vitesse voisine de celle de la lumière, comme c'est normalement le cas
pour ce type d'objet? Comment les rayons gamma s'échappent-ils du
système binaire, au lieu de se convertir en particules de matière et
d'antimatière, comme le prévoit la théorie ? D'autres observations
seront nécessaires pour mieux comprendre cette nouvelle source, la
nature de l'objet compact et la physique à l'origine de l'émission
gamma.
(CNRS) |
 09.09.2004 La
galaxie des Antennes ou le destin de la Voie lactée 09.09.2004 La
galaxie des Antennes ou le destin de la Voie lactée

|
Cette
mosaïque de la galaxie des Antennes a été acquise par le télescope
spatial infrarouge Spitzer. Elle montre les deux galaxies, NGC 4038 et
4039, qui ont fusionné ensemble, il y a environ 800 millions d'années.
Les observations de Spitzer fournissent un instantané des processus
violents nés de la formation d'étoiles déclenchés par la collision
entre les deux galaxies. La scène se déroule à quelque 68 millions
d'années-lumière et préfigure le destin de la Voie Lactée.
En
effet, la Voie Lactée et la galaxie d'Andromède entreront un jour en
collision, un processus qui désorganisera complètement les bras
spiraux des deux objets, de sorte que des étoiles s'échapperont de
leur l'attraction alors que d'autres éclateront et se percuteront
violement. De ce processus violent, naîtront une nouvelle génération
d'étoiles.
|
|
Note
: Cette mosaïque est formée de deux images, l'une dans l'infrarouge (Spitzer)
et l'autre dans le visible (Kitt Peak National Observatory). Les
étoiles observées dans le visible apparaissent en bleu et en vert
tandis que les étoiles récemment formées observées dans l'infrarouge
apparaissent en rouge. Elles sont essentiellement présentes dans les
nuages de gaz et de poussières chauffés, par les étoiles récemment
formées.
Les
deux noyaux des galaxies NGC 4038 et 4039 en plein processus de fusion
apparaissent à l'image sous la forme d'une région blanchâtre.
|
énergie sombre
 19.05
2004 l'
expansion de l'univers s'accélère
19.05
2004 l'
expansion de l'univers s'accélère
|
L' Univers est en expansion à un rythme toujours plus rapide, ont
annoncé des chercheurs britanniques. Ces conclusions se fondent sur
l'observation de "l'énergie sombre" à l'aide du télescope
spatial à rayons-X Chandra.
|
|

|
"
L' Univers accélère vraiment, c'est une confirmation directe qui a
d'importantes implications pour l'avenir de notre Univers", a
estimé Steve Allen, astrophysicien. " L'énergie sombre pousse
l'Univers vers l'extérieur et accélère son expansion",
a-t-il ajouté.
Les
chercheurs ignorent la composition cette énergie. Mais ils estiment que
sa densité détermine le rythme de l'expansion de l'Univers. "
L'expansion de l'Univers s'accélère et la question est maintenant de
comprendre pourquoi", a commenté Paul Hertz, chercheur de la
Nasa.
"Jusqu'à ce que nous ayons compris ce qui compose l'énergie
sombre, toutes les options sont possibles" pour l'avenir de
l'Univers, a-t-il dit.
(AFP)
|
 24.11.2005 Énergie
noire ou constante cosmologique ? 24.11.2005 Énergie
noire ou constante cosmologique ?
|
 Les
premiers résultats obtenus par la collaboration internationale SNLS (SuperNova
legacy Survey) montrent que la mystérieuse "énergie noire", présumée
responsable de l'accélération de l'expansion de l'Univers, pourrait être
la constante cosmologique d'Einstein. Les
premiers résultats obtenus par la collaboration internationale SNLS (SuperNova
legacy Survey) montrent que la mystérieuse "énergie noire", présumée
responsable de l'accélération de l'expansion de l'Univers, pourrait être
la constante cosmologique d'Einstein.
Il y a encore quelques années, les astrophysiciens pensaient que
l'expansion de l'Univers mise en évidence par Edwin Hubble dans les
années 1920, ralentissait sous l'effet de la gravitation. Or, en 1998,
des chercheurs ont observé que les supernovae lointaines apparaissaient
moins lumineuses qu'attendu dans un Univers en expansion décélérée. En
fait, loin de décélérer, l'expansion de l'Univers accélère sous l'effet
d'une mystérieuse énergie, baptisée "énergie noire".
Aujourd'hui, l'Univers semble être composé pour un quart environ de
matière et pour le reste d'énergie noire qui agit sur l'expansion de
l'Univers comme une force répulsive. Matière et énergie noire se
comportent différemment vis-à-vis de l'expansion de l'Univers: la
matière se dilue alors que l'énergie noire ne se dilue pas ou peu.
Des supernovae comme instruments de mesure
- Les supernovae sont des explosions d'étoiles en fin de vie. Elles sont
très lumineuses et peuvent donc servir de "bornes kilométriques" dans
l'Univers, car leur brillance apparente mesure la distance à laquelle
elles se trouvent. Ainsi, lorsque l'on observe des supernovae, on peut
mesurer leur distance et la vitesse à laquelle elles s'éloignent (par
leur décalage vers le rouge) et donc en déduire la vitesse d'expansion
de l'Univers.
Le SNLS a mesuré les distances de 71 supernovae dont les plus lointaines
ont explosé quand l'Univers avait moins de la moitié de son âge actuel.
L'objectif de ce projet est de faire une mesure précise de l'énergie
noire et de déterminer sa nature, qui reste pour l'heure inconnue. Il
est cependant possible en mesurant le flux des supernovae distantes, de
déterminer si elle se comporte comme la constante cosmologique
d'Einstein (qui peut-être définie comme l'énergie constante dans le
vide) ou selon de nombreuses autres hypothèses théoriques. Ce qui
distingue ces théories, c'est la dilution ou pas de la densité d'énergie
noire avec l'expansion de l'Univers. La mesure publiée aujourd'hui est
la plus précise et favorise l'absence de dilution.
(techno-science.net)
|
les étoiles
 07.05.2007 Explosion
d'une supernova d'une luminosité jamais vue
07.05.2007 Explosion
d'une supernova d'une luminosité jamais vue
|
L'explosion spectaculaire d'une supernova ayant produit une luminosité
d'une intensité jamais vue précédemment, a été observée l'automne
dernier par des astronomes américains, a annoncé la Nasa. Utilisant des
télescopes terrestres (Keck et Lick) et spatial (Chandra X-Ray), ces
scientifiques ont pu voir l'explosion d'une étoile géante ayant émis une
luminosité cinq fois plus intense qu'aucune des centaines de supernovae
observées jusqu'alors.
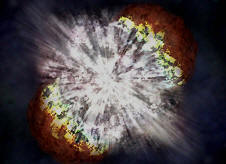 De
toutes les explosions d'étoiles vue précédemment, celles-ci a été de
loin la plus puissante", a indiqué Alex Filippenko, l'un des astronomes
ayant fait cette découverte. "Nous avons été surpris de l'intensité
lumineuse et aussi de sa durée (70 jours)", a-t-il ajouté dans un
communiqué. Sa luminosité a atteint 50 milliards de fois celle de notre
soleil. De
toutes les explosions d'étoiles vue précédemment, celles-ci a été de
loin la plus puissante", a indiqué Alex Filippenko, l'un des astronomes
ayant fait cette découverte. "Nous avons été surpris de l'intensité
lumineuse et aussi de sa durée (70 jours)", a-t-il ajouté dans un
communiqué. Sa luminosité a atteint 50 milliards de fois celle de notre
soleil.
Dans la communauté astronomique on pense généralement que les premières
étoiles nées après le Big Bang étaient tout aussi massives que celle
dont l'explosion a été observée l'automne dernier ce qui pourrait offrir
un rare témoignage sur la manière dont de telles supernovae finissaient
leur existence.
L'étoile qui a produit la supernova SN 2006gy a apparemment rejeté une
grande quantité de sa masse avant d'exploser. Cette importante perte de
masse est similaire à ce qui est actuellement observée avec l'étoile Eta
Carina, qui se trouve dans notre galaxie, la Voie Lactée. Cette
observation conduit les astronomes à se demander si Eta Carina est en
passe de devenir une supernova proche de l'explosion. Alors que la
supernova SN 2006gy se trouvait dans la galaxie NGC 1260 à quelque 240
millions années-lumière de la Terre, Eta Carina n'est qu'à 7.500
années-lumière.
Une supernova représente l'évolution d'une étoile massive, environ huit
à vingt fois la masse de notre soleil et qui implose sous la force de sa
propre gravité pour former un trou noir, sorte de siphon cosmique dont
rien n'échappe, pas même la lumière. Dans le cas de SN 2006gy, les
astronomes pensent que l'explosion a résulté d'un mécanisme différent
alors que cette étoile avait une masse beaucoup plus grande de l'ordre
de 150 fois celle de notre soleil. Des étoiles aussi massives sont très
rares soulignent ces astronomes selon lesquels la Voie Lactée pourrait
en compter seulement une dizaine sur les quelque 400 milliards d'étoiles
que compte notre galaxie.
(WASHINGTON - AFP) |
 25.02.2008 métamorphose
stellaire
25.02.2008 métamorphose
stellaire
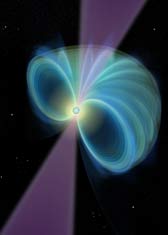 Un
peu comme dans Doctor Jekyll & Mister Hyde, des chercheurs de la
NASA et de l'Université McGill ont découvert un pulsar d'apparence
normale qui s'est transformé en magnétar, une variété d’étoiles à
neutron beaucoup plus rare, un évènement jamais observé auparavant. Un
peu comme dans Doctor Jekyll & Mister Hyde, des chercheurs de la
NASA et de l'Université McGill ont découvert un pulsar d'apparence
normale qui s'est transformé en magnétar, une variété d’étoiles à
neutron beaucoup plus rare, un évènement jamais observé auparavant.
Les pulsars et les magnétars font partie de la même famille stellaire.
Tous les deux sont en fait des étoiles à neutrons, des objets de très
petite taille (diamètre de 10 à 20 km) mais pesant aussi lourd que le
soleil. Une étoile à neutrons représente le « cadavre » d’une étoile
bien plus massive qui s’est effondrée sur elle-même lors d’une
supernova.
Les pulsars,
de loin le type le plus courant, ont une rotation très rapide. Ils
émettent des ondes radioélectriques sous la forme d’un signal périodique
correspondant à la période de rotation de l’astre. Ces ondes sont
tellement régulières que lorsqu'elles ont été détectées pour la première
fois dans les années 1960, les chercheurs ont envisagé la possibilité
qu'il s'agisse de signaux provenant d'une civilisation extraterrestre.
Les magnétars
sont en revanche des étoiles à neutrons à rotation lente qui puisent
leur énergie de champs magnétiques extrêmement puissants, les plus forts
de l'Univers. Ils sont beaucoup plus rares que les pulsars et on en
dénombre que quelques uns dans notre galaxie. Ils produisent des
rayonnements de haute énergie, comme les rayons X et gamma. Les
astronomes s’interrogent encore sur l’origine des magnétars et sur
l’éventuelle « filiation » qu’il existe avec les pulsars.
La
découverte, relatée dans la revue Science de cette semaine, d’un pulsar
se métamorphosant en magnétar est donc d’importance, les scientifiques
identifient ainsi pour la première fois un objet de transition. Ils ne
savent pas encore si cette transformation est définitive ou si le pulsar
à adopté momentanément certaines caractéristiques d’un magnétar.
D’autres observations seront nécessaires pour trancher cette question et
déterminer si les magnétar passent tous par une phase juvénile où ils
ont l’apparence d’un pulsar.
(nouvelobs.com) |
 18.11.2006
Double regard sur la nébuleuse
d’Orion 18.11.2006
Double regard sur la nébuleuse
d’Orion
|
 Ce
drôle de personnage bleuté qui semble voler dans les airs est au cœur de
la nouvelle image obtenue par la NASA de la nébuleuse d’Orion, une
importante fabrique d’étoiles massives située à 1.500 années lumière de
la Terre. Ce
drôle de personnage bleuté qui semble voler dans les airs est au cœur de
la nouvelle image obtenue par la NASA de la nébuleuse d’Orion, une
importante fabrique d’étoiles massives située à 1.500 années lumière de
la Terre.
Les visions des télescopes spatiaux Spitzer et Hubble, dans plusieurs
longueurs d’ondes lumineuses, ont été réunies pour fabriquer cette
image, présentée ici en fausses couleurs. Au centre du cliché une tache
jaune clair trahit la présence d’étoiles jeunes très massives, dont
certaines sont 100.000 fois plus brillantes que notre Soleil, qui
forment l’amas du Trapèze.
Les traînées vertes, vues par Hubble dans l’ultraviolet et la lumière
visible, sont des nuages gazeux d’hydrogène et de souffre chauffés par
le rayonnement UV intense des étoiles du Trapèze. Les nuages rouges et
orange, détectés par Spitzer dans l’infrarouge, sont riches en molécules
organiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques).
Les jeunes étoiles enveloppées dans leur cocon de gaz sont visibles sous
forme de petits points orange ou jaunes, grâce à Spitzer. Hubble a de
son côté mis en évidence les étoiles plus mûres, en bleu ou en vert. (science
et avenir) |
 08.11.2006
Un soleil lointain en furie 08.11.2006
Un soleil lointain en furie
|
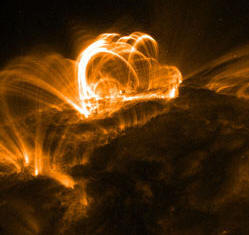 Les
chercheurs ont observé une éruption solaire très violente, peut-être la
plus forte jamais détectée. Si elle s’était produite sur notre Soleil,
l’atmosphère protectrice de la Terre aurait été mise à mal et une
nouvelle extinction de masse se serait produite. Heureusement, c’est à
135 années lumière de la Terre que l’éruption a eu lieu, sur une étoile
de la constellation de Pégase, en décembre 2005. Les
chercheurs ont observé une éruption solaire très violente, peut-être la
plus forte jamais détectée. Si elle s’était produite sur notre Soleil,
l’atmosphère protectrice de la Terre aurait été mise à mal et une
nouvelle extinction de masse se serait produite. Heureusement, c’est à
135 années lumière de la Terre que l’éruption a eu lieu, sur une étoile
de la constellation de Pégase, en décembre 2005.
Cette éruption a libéré une quantité d’énergie cent millions de fois
supérieure à celle d’une éruption similaire sur notre Soleil, selon
Rachel Osten (University of Maryland, NASA, USA) et ses collègues.
Les éruptions se produisent dans la couronne du Soleil, la partie
externe de l’atmosphère solaire. Elles résultent de l’accélération de
particules à des énergies considérables. Sur le Soleil elles durent
quelques minutes et notre étoile ne peut pas engendrer d’éruptions aussi
destructrices.
En revanche, l’étoile qui a produit cette violente éruption fait partie
d’un binôme, appelé Pegasi II. Les deux étoiles sont un peu plus petites
que le Soleil mais comme elles sont très proches l’une de l’autre elles
s’entraînent mutuellement et tournent sur elles-mêmes en sept jours
seulement (contre 28 pour le Soleil), ce qui favorise les éruptions.
Celle de décembre 2005 était suffisamment violente pour déclencher le
système d’alerte du télescope Swift, calibré pour repérer des phénomènes
encore plus énergétiques, les sursauts gamma. Les astrophysiciens ont
très vite compris qu’il ne s’agissait pas d’un sursaut mais d’une
éruption solaire.
(science&avenir) |
 24.03.2006 Des
astronomes découvrent deux étoiles étroitement enlacées 24.03.2006 Des
astronomes découvrent deux étoiles étroitement enlacées
|
Des astronomes allemands ont découvert un système binaire dont les deux
petite étoiles sont tellement proches que l'ensemble tiendrait à
l'intérieur de notre Soleil. Les deux astres sont séparés par 1,4 million
de kilomètres et tournent l'un autour de l'autre en sept heures, a indiqué
l'équipe menée par Thorsten Nagel, de l'Université de Tübingen
(Allemagne), dans un communiqué reçu vendredi.
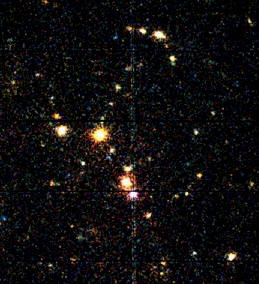 Cette
découverte est particulièrement intrigante parce que la plus grosse des
deux étoiles, d'une masse équivalente à 60% de celle du Soleil, est un
astre de type "PG1159", souligne M. Nagel. A la fin de sa vie, une étoile
de type "PG1159" a connu une ultime bouffée d'activité et est devenue
brièvement une géante rouge, avant de s'étioler sous forme de naine
blanche. Il y a quelques centaines de milliers d'années, l'étoile faisait
plusieurs centaines de fois la taille de notre Soleil. Comment son actuel
compagnon s'en est-il donc rapproché aussi près et comment a-t-il survécu
à une telle fournaise ? s'interrogent les scientifiques allemands. Cette
découverte est particulièrement intrigante parce que la plus grosse des
deux étoiles, d'une masse équivalente à 60% de celle du Soleil, est un
astre de type "PG1159", souligne M. Nagel. A la fin de sa vie, une étoile
de type "PG1159" a connu une ultime bouffée d'activité et est devenue
brièvement une géante rouge, avant de s'étioler sous forme de naine
blanche. Il y a quelques centaines de milliers d'années, l'étoile faisait
plusieurs centaines de fois la taille de notre Soleil. Comment son actuel
compagnon s'en est-il donc rapproché aussi près et comment a-t-il survécu
à une telle fournaise ? s'interrogent les scientifiques allemands.
Le système formé par les deux étoiles, baptisé poétiquement
SDSSJ1212531.92-010745.9, a été découvert à l'automne 2005. C'est le
premier système binaire connu dont l'une des composantes est une PG1159,
dont on ne recense actuellement qu'une quarantaine d'exemplaires.
Contrairement à la plupart des étoiles, l'étoile PG1159 a pratiquement
entièrement consommé son hydrogène, mais est riche en oxygène, hélium et
carbone. Sa température de surface est de l'ordre de 90.000 degrés. Son
petit compagnon (40% de la masse du soleil) est beaucoup plus froid, avec
une température de 3.000°. Mais l'irradiation massive reçue de l'autre
étoile chauffe sa surface jusqu'à 8.200°, provoquant des dégagements
d'hydrogène qui ont permis aux astronomes de découvrir l'existence de ce
système double.
(AFP) |
 03.11.2005 radiations
lumineuses provenant des premières étoiles de l'univers 03.11.2005 radiations
lumineuses provenant des premières étoiles de l'univers
|
 Des
astronomes américains pensent avoir capté des radiations d'étoiles nées
à l'aube de l'univers et depuis longtemps éteintes. Si ces observations
faites avec le télescope de l'espace Spitzer de la Nasa sont confirmées,
elles lèveront un peu le voile sur une période très proche du "big bang"
qui selon la théorie des cosmologues a donné naissance à l'univers il y
a environ 13,7 milliards d'années. Des
astronomes américains pensent avoir capté des radiations d'étoiles nées
à l'aube de l'univers et depuis longtemps éteintes. Si ces observations
faites avec le télescope de l'espace Spitzer de la Nasa sont confirmées,
elles lèveront un peu le voile sur une période très proche du "big bang"
qui selon la théorie des cosmologues a donné naissance à l'univers il y
a environ 13,7 milliards d'années.
Ces rayonnements lumineux pourraient provenir des toutes premières
étoiles ou peut-être de gaz brûlants avalés par les premiers trous
noirs, ont expliqué ces astronomes du Goddard Space Flight Center de la
Nasa. Mais ces jets lumineux sont trop distants et faibles pour
distinguer les objets qui les émettent.
Cette observation de dix heures avec la caméra infra-rouge du téléscope
spatial Spitzer dans la constellation du Dragon a permis de détecter des
jaillissements diffus de rayons infra-rouges, invisibles à l'oeil nu
dont l'intensité est plus faible que la lumière optique. Ces radiations
provenaient probablement d'étoiles dites de "Population III", première
génération hypothétique des corps stellaires dont les scientifiques
pensent qu'ils se sont formés cent millions d'années après le "Big
Bang". La première et seconde génération d'étoiles, dites de "Population
I et II" se sont formées deux cent millions d'années plus tard.
La découverte faite avec le télescope Spitzer va dans le sens des
observations faites dans les années 90 par le satellite de la Nasa, "Cosmic
Background Explorer" selon lesquelles il existerait des sources de
rayonnement infrarouge ne provenant pas des étoiles connues. Ces
dernières détections confirment aussi des observations de la sonde
"Wilkinson Microwave Anisotropy" de la Nasa en 2003 qui dataient la
naissance des premières étoiles entre 200 et 400 millions d'années après
le Big Bang.
(AfP)
|
 01.06.2005 Le
télescope Spitzer de la Nasa a vu naître 100.000 étoiles
01.06.2005 Le
télescope Spitzer de la Nasa a vu naître 100.000 étoiles
 |
Le télescope spatial Spitzer, doté d'un appareil photo infrarouge, a
repéré la naissance d'environ 100.000 étoiles dans un nuage de gaz
entourant une étoile située à 10.000 années-lumière de la Terre, a
annoncé l'agence spatiale américaine (Nasa).
Une image prise par Spitzer montre la nébuleuse Carina dont, selon des
chercheurs, les radiations et les vents émanant d'un ensemble de grosses
étoiles ont fragmenté les nuages de gaz et de poussière qui, une fois
comprimés, ont formé de nouvelles étoiles.
L'appareil photo de Spitzer a pris des clichés en perçant, pour la
première fois, ces nuages, montrant de nouvelles étoiles en formation
dans des colonnes de poussière émanant d'Eta Carinae, l'une des plus
grosses étoiles de la nébuleuse, a expliqué la Nasa. |
|
Eta Carinae est elle-même issue de Carina Nebula, un vaste nuage de
poussière et de gaz s'étalant sur 200 années-lumière, dans la Voie
lactée. Eta Carinae fait plus de 100 fois la taille du Soleil, et fut à
une époque la deuxième étoile la plus brillante. Les chercheurs pensent
qu'elle va bientôt mourir.
(AP) |
 04.03.2004 V838
Monocerotis
04.03.2004 V838
Monocerotis
|

|
Le
télescope spatial Hubble a réalisé une image d'une étoile lointaine,
appelée V838 Monocerotis.
Située
dans la constellation de la Licorne, cette étoile se trouve à quelques
20.000 années-lumière de la Terre. S'étant
subitement transformée en nova, V838 Monocerotis a amplifié son éclat
de 600.000 fois devenant pour un bref instant l'une des étoiles les
plus brillantes de la Galaxie.
"L'illumination
de poussière stellaire provient de l'étoile géante rougeoyante au
centre de l'image", expliquent les agences spatiales dans
un communiqué conjoint en qualifiant cette vue d' "oeuvre d'art
de la nature". |
 12.04.2006 Véga,
étoile encore mystérieuse 12.04.2006 Véga,
étoile encore mystérieuse
|
Astre principal de la constellation de la Lyre, Véga est une étoile
proche, située seulement à 25 années-lumière du Soleil. Elle a longtemps
été considérée comme une étoile de référence, et c'est à elle que l'éclat
de toutes les autres est comparé.
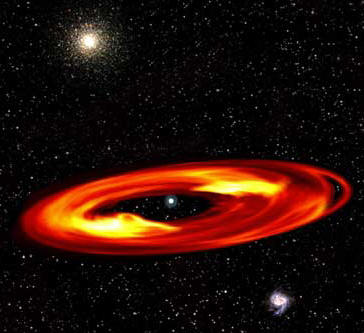 Elle
est environ trois fois plus grosse et plus massive que le Soleil, 60 fois
plus lumineuse et beaucoup plus jeune (350 millions d'années contre 4,5
milliards). Elle
est environ trois fois plus grosse et plus massive que le Soleil, 60 fois
plus lumineuse et beaucoup plus jeune (350 millions d'années contre 4,5
milliards).
A l'aide du réseau de télescopes CHARA recombiné par l'instrument français
FLUOR, une équipe internationale comprenant des astronomes français,
belges, suisses et américains a détecté dans son voisinage un faible flux
infrarouge qui semble issu de particules chauffées par l'étoile jusqu'à
quelque 1.300 degrés Celsius. Ces particules auraient une composition
chimique différente de celles du système solaire, avec une prédominance de
matériaux carbonés (comme le graphite), alors que notre nuage zodiacal
contient surtout des silicates. Elles seraient aussi en moyenne toutes
petites.
Des grains aussi minuscules, expliquent les chercheurs, devraient
normalement être repoussés par la pression créée par le rayonnement de
Véga. Leur abondance prouve donc qu'ils se produisent en permanence,
probablement dans une phase d'intense bombardement météoritique et
cométaire comme celle qu'a connue la Terre aux origines du système
solaire. Le taux de production des poussières correspondrait au passage
quotidien de 13 grosses comètes dans l'environnement de Véga. La présence
de poussières froides autour de Véga (-170°C) était connue. Cependant, on
ne savait rien sur la partie interne de ces disques de débris, où des
planètes semblables à la Terre sont censées se former, ajoutent les
scientifiques. Cela ajoute de l'incertitude aux connaissances sur la
composition élémentaire de l'étoile et sur son âge, et suggère que son
disque de débris pourrait être sensiblement plus ancien qu'on ne pensait.
(AFP) |
 10.03.2004 toujours
plus LOIN
10.03.2004 toujours
plus LOIN
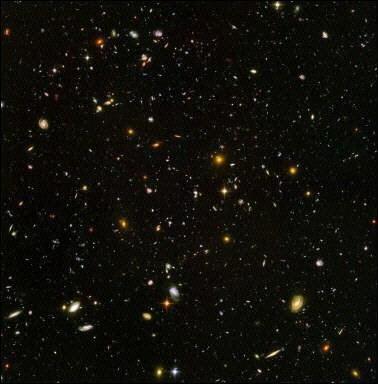 |
Le
télescope spatial Hubble a permis d'obtenir cette image éloignée de
l'univers datant de quelques centaines de millions d'années après le
Big Bang. Cette image contiendrait
environ 10.000 galaxies !
"Une
longue exposition a permis de saisir de la lumière ayant voyagé dans
l'espace pendant plus de 13 milliards d'années" souligne
Steven Beckwith, directeur de l'Institut. "Pour
la première fois, nous regardons des étoiles qui se forment sur les décombres
du Big Bang"
"L'exploration
de cette frontière devra attendre la mise en service du Télescope
James Webb, que la NASA prévoit de lancer en 2011.
" Un
examen rapide des images montrant les objets les plus lointains révèle
une grande variété de galaxies de différentes tailles, formes et
couleurs. Certaines présentent une forme inhabituelle." (AP) |
 30.08.2006 L'explosion
d'une supernova observée pour la 1ère fois en direct 30.08.2006 L'explosion
d'une supernova observée pour la 1ère fois en direct
|
 L'explosion
d'une supernova, étoile massive en fin de vie, a été observée pour la
première fois en direct dans notre galaxie par une équipe
américano-britannique qui rapporte dans la revue britannique Nature les
détails de cet événement exceptionnel. Les explosions de supernova sont
des phénomènes très rares -- quatre au cours du dernier millénaire dans
notre galaxie -- et ont toujours été détectées après l'événement grâce à
la localisation d'un éclat extraordinaire. L'explosion
d'une supernova, étoile massive en fin de vie, a été observée pour la
première fois en direct dans notre galaxie par une équipe
américano-britannique qui rapporte dans la revue britannique Nature les
détails de cet événement exceptionnel. Les explosions de supernova sont
des phénomènes très rares -- quatre au cours du dernier millénaire dans
notre galaxie -- et ont toujours été détectées après l'événement grâce à
la localisation d'un éclat extraordinaire.
L'événement décrit dans Nature a commencé à se produire le 18 février
2006 dans une galaxie située à quelque 440 millions d'années-lumière,
vers la constellation du Bélier. Les astronomes ont observé un
rayonnement gamma inhabituel, qui a duré près de 40 minutes, alors que
la durée d'un tel phénomène est généralement de l'ordre de quelques
millisecondes ou dixièmes de secondes. Ce type d'émission est considéré
comme précurseur d'une supernova. La période de rayonnement a été si
longue que le satellite de la Nasa Swift a pu focaliser tous ses
instruments sur le phénomène, les astronomes à Terre réussissant même à
observer l'explosion de l'étoile avec leurs télescopes.
"Cette émission de rayonnement gamma a été le plus extraordinaire objet
en évolution jamais enregistré par Swift", a estimé un des membres de
l'équipe d'astronomes, Paul O'Brien, de l'université de Leicester
(Grande-Bretagne) : "un objet s'éclairant lentement, puis pâlissant".
Les observations, selon lui, font penser à "une giclée importante qui
s'est répandue dans la région, mais qui était accompagnée d'une bulle de
gaz incroyablement chaude - deux millions de degrés - et se mouvant plus
lentement, produite par l'onde de choc de l'étoile en train d'exploser".
Cette supernova était une étoile massive d'une masse vingt fois
supérieure à notre Soleil, selon les astronomes. L'explosion de ces
corps céleste se produit lorsqu'ils ont épuisé leur combustible
nucléaire. Leur noyau implose brutalement lorsque les réactions
thermonucléaires s'y arrêtent.
(pARIS - aFp) |
 27.06.2007 une
étoile nuageuse
27.06.2007 une
étoile nuageuse
|
Les prévisions météorologiques ne seraient
pas réservées aux planètes et à leurs satellites. Certaines étoiles
connaîtraient aussi des phénomènes relevant de la météorologie, comme le
montre l’observation de nuages de mercure sur l’étoile Alpha Andromède. |
|
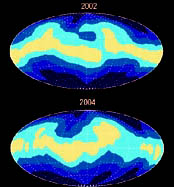
Répartition des nuages
de mercure (couleur clair)
sur Alpha Andromède. (Nature) |
Située à 95 années lumière de la Terre, cette étoile trois fois plus
massive et deux fois plus chaude que le Soleil est très riche en mercure
et en manganèse. De précédentes observations ont révélé que la
composition de son atmosphère variait considérablement, avec une
répartition inégale du mercure.
Pour les étoiles comme le Soleil qui ont un puissant champ magnétique,
les structures observées à la surface –comme les taches et les facules-
ou dans les couches supérieures de l’atmosphère, sont liées aux lignes
du champ magnétique. Cependant Alpha Andromède n’a quasiment pas de
champ magnétique.
Après sept années d’observation de l’étoile, l’équipe d’Oleg Kochukhov
(Uppsala University, Suède) pense avoir trouvé l’explication. Les
concentrations variables de mercure sur Alpha Andromède sont en fait des
nuages de mercure qui se déplacent dans l’atmosphère, comme les nuages
dans l’atmosphère terrestre, expliquent les chercheurs dans la revue
Nature Physics (édition électronique, 24 juin). Restent à comprendre
comment se forment les nuages de mercure et comment ils circulent.
(Sciences et
Avenir.com) |
 23.11.2007 des
naines blanches qui sortent de l'ordinaire
23.11.2007 des
naines blanches qui sortent de l'ordinaire
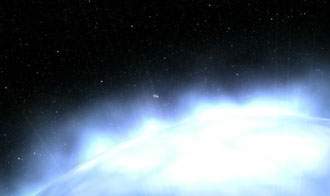 |
Plus
les astrophysiciens fouillent le ciel, plus leur cabinet de curiosités
s’agrandit… Dernière trouvaille en date : des naines blanches, vestiges
d’étoiles qui ont consommé tout leur carburant, entourées d’une
atmosphère de carbone. Jusqu’à présent toutes les naines blanches
connues baignent dans un mélange d’hélium et d’hydrogène.
Les naines blanches résultent en effet de l’effondrement d’étoiles de
faible masse qui, après avoir perdu leurs couches externes, ne gardent
qu’un noyau de carbone et d’oxygène entouré d’une couche d’hélium et,
dans la plupart des cas, d’une autre couche d’hydrogène. |
|
Pourtant, parmi les millions d’objets catalogués par le Sloan Digital
Sky Survey, un très vaste projet de recensement du ciel, Patrick Dufour
et ses collègues ont identifié huit naines blanches dont l’atmosphère
n’est composée que de carbone. Ils n’ont même pas trouvé trace d’hélium
ou d’hydrogène.
Ces astrophysiciens cherchent donc de nouvelles hypothèses pour
expliquer cette curiosité. «Nous observons peut-être directement le cœur
nu de l’étoile, […] les cendres des anciennes réactions nucléaires»
suggère Patrick Dufour dans le communiqué de son université.
(nouvelobs.com) |
astéroïdes
 29.09.2004 L'astéroïde
Toutatis 29.09.2004 L'astéroïde
Toutatis
|
Toutatis, un gros astéroïde de 4,6 km de long sur 2,4 km de large fonce en direction de la Terre qu'il frôlera
mercredi, mais sans présenter de danger de collision. "Ce sera le plus gros objet céleste depuis
le début de ce siècle à passer aussi près de notre planète", a indiqué
dans un communiqué Steven Ostro un expert du "Jet Propulsion Laboratory"
de la Nasa. |
 |
La trajectoire de Toutatis est la plus scrutée depuis plusieurs années
par les experts de la Nasa en raison de l'énorme danger que
représenterait pour la Terre une collision avec un objet d'une telle
masse. Ils en ont conclu avec la plus grande certitude que Toutatis ne
présente, tout au moins pendant 558 ans, aucun risque pour notre planète
puisqu'il passera mercredi, à précisément 13H37 GMT, au point le plus
près à 1.549.719 km. C'est quatre fois la distance de la Terre à la Lune
(400.000 km) mais un saut de puce à l'échelle de l'univers.
Selon les calculs des astrophysiciens, Toutatis repassera de nouveau à
proximité de notre planète en 2562 mais cette fois à seulement 400.000
km. Si Toutatis entrait en collision avec la Terre, la puissance de
destruction serait équivalente à l'explosion de plusieurs dizaine de
milliers de bombes nucléaires, soulevant d'immenses nuages de poussières
qui replongeraient la Terre dans une longue période glacière.
(AFP)
|
 01.06.2006 L'astéroïde
Itokawa: témoin précieux de l'histoire du système solaire 01.06.2006 L'astéroïde
Itokawa: témoin précieux de l'histoire du système solaire
|
 L'astéroïde
Itokawa, circulant à proximité de la Terre, est un amas de cailloux et
de sable en forme de loutre de mer qui pourrait apporter un nouvel
éclairage sur les origines du système solaire, selon des chercheurs
ayant participé à la mission japonaise Hayabusa. Cette sonde nippone a
pu photographier de près, mesurer et peut-être prélever des échantillons
du petit astre qu'elle pourrait ramener en 2010. La plupart des
astéroïdes, des déchets laissés par la formation du système solaire, ont
subi peu d'altérations minéralogiques et sont de ce fait des
laboratoires précieux pour comprendre l'histoire de la formation des
planètes. L'astéroïde
Itokawa, circulant à proximité de la Terre, est un amas de cailloux et
de sable en forme de loutre de mer qui pourrait apporter un nouvel
éclairage sur les origines du système solaire, selon des chercheurs
ayant participé à la mission japonaise Hayabusa. Cette sonde nippone a
pu photographier de près, mesurer et peut-être prélever des échantillons
du petit astre qu'elle pourrait ramener en 2010. La plupart des
astéroïdes, des déchets laissés par la formation du système solaire, ont
subi peu d'altérations minéralogiques et sont de ce fait des
laboratoires précieux pour comprendre l'histoire de la formation des
planètes.
Hayabusa ("Faucon" en japonais) s'était approchée d'Itokawa en novembre
dernier avant de se poser brièvement à sa surface pour faire des
prélèvements et les ramener sur Terre.
Mais les avaries se sont multipliées et l'agence spatiale japonaise
n'est pas sûre que la sonde ait pu récolter des échantillons d'Itikawa.
 Toutefois,
Hayabusa a pu transmettre des images et un grand nombre de données. Les
minéraux se trouvant à la surface de l'astéroïde, long comme six
terrains de football, sont similaires à ceux des météorites achondrites,
très communs et dont la teneur métallique est faible. Cette composition
indique qu'Itokawa provient de la partie intérieure de la ceinture de
dizaines de milliers d'astéroïdes tournant autour du soleil entre Mars
et Jupiter. Selon ces chercheurs, Itikawa pourrait représenter un stade
plus ancien dans l'évolution des astéroïdes. Toutefois,
Hayabusa a pu transmettre des images et un grand nombre de données. Les
minéraux se trouvant à la surface de l'astéroïde, long comme six
terrains de football, sont similaires à ceux des météorites achondrites,
très communs et dont la teneur métallique est faible. Cette composition
indique qu'Itokawa provient de la partie intérieure de la ceinture de
dizaines de milliers d'astéroïdes tournant autour du soleil entre Mars
et Jupiter. Selon ces chercheurs, Itikawa pourrait représenter un stade
plus ancien dans l'évolution des astéroïdes.
Le fait qu'Itikawa soit en grande partie formé de cailloux plutôt que
d'un seul morceau de roche, "éclaire sur la manière dont les astéroïdes
se sont formés et ont évolué ce qui devrait conduire à une meilleure
compréhension de la genèse du système solaire", a relevé Daniel Scheeres
un chercheur de l'Université du Michigan (nord). Ces cailloux sont du
même type que ceux qui frappent la Terre depuis les débuts de la
formation de la planète, a-t-il dit. (AFP) |
 01.07.2006 Un
astéroïde va passer ce week-end à proximité de la Terre 01.07.2006 Un
astéroïde va passer ce week-end à proximité de la Terre
|
 Un
énorme astéroïde, connu sous le nom de 2000 XP14, va passer ce week-end
à proximité de la Terre, sans toutefois la menacer, selon des astronomes
américains. Un
énorme astéroïde, connu sous le nom de 2000 XP14, va passer ce week-end
à proximité de la Terre, sans toutefois la menacer, selon des astronomes
américains.
Il passera à environ 432.821km de la Terre, soit à peu près 1,1 fois la
distance entre la planète bleue et la Lune. Ce chiffre peut paraître
important, mais à l'échelle spatiale, il s'agit d'une rencontre de
proximité. Le meilleur endroit pour le spectacle sera l'Amérique du
Nord, où les amateurs expérimentés munis de bons télescopes devraient
apercevoir l'astéroïde, sous la forme d'un petit point en mouvement. On
le verra aussi en Europe, mais plus difficilement encore. C'est dimanche
soir vers 21h25 heure de la côte ouest américaine (4h25 gmt) que 2000
XP14 passera au plus près de la Terre. Les astronomes ne disposent que
de peu d'informations sur ce corps céleste, découvert en 2004. D'après
sa luminosité apparente, ils estiment qu'il mesure quelque 800m de
large. Au cours des dernières années, une quarantaine d'astéroïdes sont
passés à proximité de la Terre. Mais il est "inhabituel" qu'un objet de
cette taille passe si près, selon Don Yeomans, du Jet Propulsion
Laboratory de la NASA. XP14 s'approchera de la Terre à dix reprises au
cours du XXIe siècle mais sa trajectoire ne la "menace pas", ajoute le
chercheur.
(AP) |
interrogations et recherches
 01.09.2007 un
grand vide dans l'univers
01.09.2007 un
grand vide dans l'univers
|
Les
astrophysiciens ont eux-mêmes été surpris par leur découverte : ils ont
identifié un gigantesque ‘’trou’’ dans l’univers, un vide de presque un
milliard d’années de large. Cela n’a rien à voir avec les trous noirs,
grands dévoreurs de matière. Il s’agit là d’un endroit sans matière
visible (galaxies, étoiles, gaz) ni matière noire. Du vide, donc.
Certes,
ce n’est pas la première fois que des chercheurs tombent sur des poches
de vide dans l’univers mais elles étaient de petite taille. Lawrence
Rudnick (University of Minnesota, USA) et ses collègues ne s’attendaient
pas à trouver un vide aussi vaste.
Cette
région de l’univers, située entre 6 et 10 milliards d’années de la
Terre, avait été repérée il y a trois ans à cause de sa froideur. Ce
sont les données du satellite WMAP, chargé d’étudier le fond
cosmologique diffus de l’univers -le rayonnement fossile issu de la
première lumière émise 300.000 ans environ après le Big Bang- qui ont
révélé l’anomalie. WMAP, qui mesure avec une très grande précision les
variations de températures du rayonnement fossile, a mis en évidence une
région froide dans la constellation de l’Eridan.
Grâce
au radiotélescope américain VLA (Very Large Array), qui scanne
l’intégralité du ciel, Rudnick et ses collègues ont constaté que cette
même région était dépourvue de galaxies. Les photons, les particules de
la lumière étudiées par WMAP, perdent de l'énergie lorsqu’ils travers un
espace vide de matière avant d’arriver jusqu’à nous, expliquent les
chercheurs, d’où la baisse de température repérée dans le rayonnement
fossile par le satellite.
Lawrence Rudnick et ses collègues, dont les travaux vont être publiés
dans l’Astrophysical Journal,
attendent maintenant que d’autres observations confirment leurs
résultats. Expliquer comment un tel vide peut se constituer dans
l’univers est une autre paire de manches. Aucune simulation de
l’évolution de l’univers ne prédit l’existence d’un vide de cette
taille, ajoutent les chercheurs.
(nouvelobs.com) |
 08.06.2006 Découverte
d'un système solaire peut-être similaire au nôtre à ses débuts 08.06.2006 Découverte
d'un système solaire peut-être similaire au nôtre à ses débuts
|
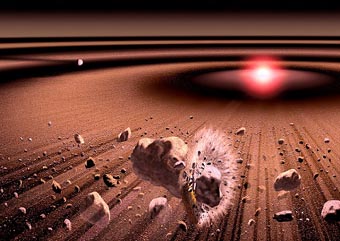 Des
astronomes américains ont découvert de vastes quantités de carbone
gazeux dans un disque de débris autour d'une jeune étoile qui pourrait
ressembler à notre système solaire à ses débuts, a annoncé la Nasa,
l'agence spatiale américaine. Des
astronomes américains ont découvert de vastes quantités de carbone
gazeux dans un disque de débris autour d'une jeune étoile qui pourrait
ressembler à notre système solaire à ses débuts, a annoncé la Nasa,
l'agence spatiale américaine.
L'étoile, baptisée Beta Pictoris et son système solaire émergeant dans
lequel des planètes pourraient s'être déjà formées, est âgée de moins de
20 millions d'années, ont précisé ces chercheurs qui ont fait cette
découverte à l'aide du télescope FUSE (Ultraviolet Spectroscopic
Explorer), d'exploration spectroscopique dans l'ultraviolet lointain.
L'abondance du carbone gazeux avec des débris formant le disque indique
que des planètes tournant autour de Beta Pictoris pourraient être des
mondes riches en graphite et méthane comme notre système solaire dans sa
première enfance. "Notre propre système solaire pourrait avoir ressemblé
à Beta Pictoris à ses débuts ou alors nous observons l'émergence d'une
nouvelle catégorie de systèmes solaires, mais dans les deux cas de
figure, ceci est fascinant", a souligné Aki Roberge.
Beta Pictoris se situe à environ 60 années-lumière (une année-lumière
est équivalent à 10.000 milliards de km) de la Terre et est 1,8 fois
plus massive que notre soleil. La jeune étoile et son disque ont été
découverts en 1984. Des observations faites avec le télescope spatial
Hubble Space indiquaient qu'une planète gazeuse de type Jupiter pourrait
s'être déjà formée dans ce disque et que des planètes rocheuses comme la
Terre seraient en formation. De telles planètes seraient trop petites et
pas assez lumineuses pour être détectées par les instruments actuels,
selon ces astronomes.
(AFP) |
 09.07
2004 a quand
remonte la
formation des galaxies ?
09.07
2004 a quand
remonte la
formation des galaxies ?
|
Une équipe d'astronomes
italiens a découvert, à l'aide du VLT, 4 galaxies massives à 10
milliards d'années-lumière. Peut-être de quoi mettre à mal toute la
théorie régissant la formation des galaxies...

D'après
la théorie la plus reconnue aujourd'hui, les galaxies primordiales,
(datées de 2 milliards d'années après le big-bang) étaient petites
et de faible masse. Puis, selon un lent processus, certaines de ces
galaxies auraient grossis jusqu'à donner ces grandes et massives
galaxies que nous connaissons aujourd'hui. Il serait alors impossible
d'observer ce type de galaxies dans l'univers lointain, c'est-à-dire
quelques millions ou milliards d'années après le big-bang.
Pour
vérifier ce scénario, une équipe d'astronomes italiens a donc
décidé d'utiliser le Very Large Telescope de l'ESO pour chercher
d'autres galaxies elliptiques situées aux plus grandes distances
possibles. Le télescope
spatial Hubble a alors montré l'existence de ces galaxies. De plus, une
analyse des spectres a mis en évidence que certaines étoiles, formant
ces galaxies, avaient des âges de 1 à 2 milliards d'années.
Des
étoiles formées il y a 12 milliards d'années, présentes dans ces
galaxies, impliquent certainement de changer de théorie... Apparemment,
certaines galaxies massives se seraient déjà en grande partie formées
alors que l'univers n'avait que 1,5 à 2,5 milliards d'années... (ISO)
|
 23.11.2004 Des
savants s'interrogent: et si l'univers n'était qu'un monde virtuel? 23.11.2004 Des
savants s'interrogent: et si l'univers n'était qu'un monde virtuel?
|
La vie sur la Terre et tout l'univers pourraient n'être qu'une simulation
informatique gigantesque, supposent le physicien Martin Rees et le
mathématicien John Barrow. La question de l'existence réelle du monde,
posée par les penseurs de toutes les époques, est renouvelée selon eux par
les progrès fantastiques et continuels de l'informatique. "Il y a quelques
décennies, les ordinateurs n'étaient capables de reproduire que des
schémas très simples, explique à l'AFP Martin Rees. Ils peuvent maintenant
créer des mondes virtuels avec de nombreux détails". |
|
 |
"A terme, observe-t-il, on pourrait imaginer des ordinateurs qui
seront capables de simuler des mondes peut-être aussi compliqués que
celui dans lequel nous pensons vivre".
Ce n'est qu'une théorie, ajoute Sir Martin, l'un des cosmologues
(spécialistes des lois physiques de l'univers) vedettes de
l'université de Cambridge (centre est de l'Angleterre). Mais "elle
doit nous conduire à nous demander si nous-mêmes pourrions nous
trouver dans une telle simulation".
L'univers, dans ce cas, ne serait pas un tout mais une partie d'un
ensemble que Martin Rees et John Barrow appellent des "multivers".
|
|
Mais John Barrow ne s'appuie pas que sur l'informatique pour envisager que
nous vivons peut-être dans "un univers simulé". Le plus troublant, selon
lui, est l'équilibre infiniment subtil des conditions naturelles rendant
la vie possible sur Terre. Un équilibre, suggère le chercheur, qui
pourrait même s'avérer trop délicat pour se perpétuer sans que "de légers
changements" lui soient apportés de temps à autre.(aFp)
|
 25.05.2005 Une
théorie du chaos expliquerait plusieurs des énigmes du système solaire
25.05.2005 Une
théorie du chaos expliquerait plusieurs des énigmes du système solaire
|
Des astronomes américains affirment avoir élaboré une histoire du chaos
originel dans le système solaire qui expliquerait plusieurs mystères sur
l'état actuel de notre environnement cosmique, selon une étude publiée
jeudi dans la revue scientifique "Nature". Le scénario élaboré par les
chercheurs permettrait notamment de répondre aux questions suivantes:
|
|
 |
Qu'est-ce qui a déclenché le bombardement d'astéroïdes, il y a quelque
3,9 milliards d'années, qui a creusé d'immenses cratères aujourd'hui
visibles sur la lune et a pu retarder l'apparition de la vie sur Terre?
Pourquoi Jupiter et Saturne ont quitté leur orbite circulaire pour
adopter la trajectoire plus ovale observée aujourd'hui ? Pourquoi
Jupiter partage son orbite avec des milliers d'astéroïdes qui le
précèdent et le suivent autour du soleil ? Les chercheurs ont eu recours
à des simulations par ordinateur pour étudier la manière dont la
périphérie du système solaire avait pu se développer. |
|
Leur théorie reprend l'idée répandue qu'il y a 4,6 milliards d'années,
le soleil et les planètes se sont formées à partir de l'effondrement
gravitationnel d'un nuage de gaz, de poussières et de glace. Mais elle
adopte l'hypothèse controversée selon laquelle le système solaire aurait
été dans un premier temps assez compact. En vertu de cette théorie,
Neptune aurait par exemple vu le jour beaucoup moins loin du soleil que
ne le pensent généralement les scientifiques. La question est de savoir
ce qui s'est passé au fil du temps alors que les planètes suivaient des
orbites circulaires et qu'elles étaient entourées par un énorme anneau
de débris planétaires, des décombres mesurant jusqu'à plusieurs
centaines de kilomètres de diamètre.
Selon le scénario avancé par la nouvelle étude, les planètes ont attiré
les débris, mais la force gravitationnelle de ces derniers a eu pour
effet d'éloigner Uranus, Neptune et Saturne du soleil. Ce changement a
rallongé le temps mis par les trois planètes pour accomplir une
révolution autour de leur étoile. Et à un moment donné, Saturne a mis
deux fois plus de temps que Jupiter pour décrire une orbite complète. En
raison de leur attraction réciproque, Jupiter et Saturne ont commencé à
quitter leur orbite circulaire pour suivre une trajectoire plus ovale
similaire à celle observée actuellement. Le phénomène a provoqué des
perturbations gravitationnelles, rendant les orbites d'Uranus et
Neptune, des planètes beaucoup moins massives, "totalement folles". Les
deux astres ont ainsi été repoussés vers l'extérieur du système solaire
dans l'anneau de débris planétaires, ce qui a provoqué un éparpillement
de ces décombres. Une conséquence a été le bombardement d'astéroïdes
subi par la Terre et la lune. La force gravitationnelle des débris a
finalement conduit Uranus et Neptune vers leur orbite actuelle, selon le
scénario avancé par les chercheurs, qui expliquerait également
l'inclinaison de l'orbite des quatre planètes évoquées.
(AP) |
 18.10.2005 La
vie peut foisonner partout dans l'Univers 18.10.2005 La
vie peut foisonner partout dans l'Univers
|
Une équipe de scientifiques du Centre Ames de la NASA a permis de démontrer
que les éléments primordiaux du vivant, selon notre conception de la vie, sont
très courants dans l'Univers de sorte que la vie peut foisonner un peu
partout. L'équipe du Centre Ames de la NASA a démontré que les PAHs
(hydrocarbures aromatiques polycycliques) sont en fait responsables du
mystérieux rayonnement infrarouge que les astronomes observaient sans pouvoir
en déterminer la nature. Le télescope spatial dans l'infrarouge Spitzer de la
NASA a détecté la signature infrarouge de ces molécules partout dans la Voie
Lactée, mais également dans d'autres galaxies proches ou très lointaines.
Reste que si cette découverte est importante pour les astronomes, elle l'est
moins pour les astrobiologistes, ces scientifiques qui recherchent la vie
ailleurs que sur Terre. |
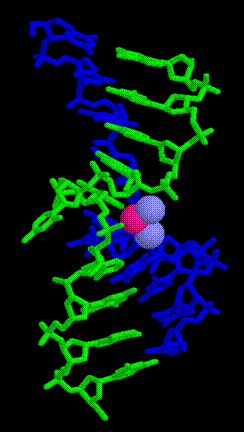 |
Mais, ce qui est intéressant dans cette découverte, c'est la présence
d'azote dans la structure de ces molécules. Or, cela change tout. Une
grande partie de la chimie de la vie, y compris l'ADN, repose sur des
molécules organiques qui contiennent de l'azote. Ainsi, la chlorophylle,
cette substance qui permet la photosynthèse des plantes est un bon
exemple de cette classe de molécules composées appelées PANHs (Polycyclic
aromatic nitrogen heterocycles).
Cette découverte renforce également la théorie selon laquelle la vie
vient de l'espace. En effet, ces molécules se forment dans la matière
expulsée par les étoiles en fin de vie A l'évidence, ces molécules sont
soufflées dans le milieu interstellaire par les vents stellaires et
enrichissent de gigantesques nuages de gaz et de poussière à l'intérieur
desquels se forment les étoiles et leur système planétaire.
|
|
Les planètes alors récemment formées sont bombardées des résidus de leur
formation et enrichies en éléments chimiques présents autour de l'étoile.
Cette découverte montre que les molécules nécessaires aux balbutiements de
la vie se trouvent en abondance dans tout l'Univers et que si d'aventure
elles sont déposées sur une planète qui présente un environnement
hospitalier à leur évolution, alors, rien n'empêche la vie d'émerger.
(Flashespace) |
HOME

 |
![]() Intro
Intro
![]() Mythes
Mythes
![]() Science
Science
![]() SPACE
News
SPACE
News
![]() futurs
futurs
![]() Mystères
Mystères
![]() Livres
Livres
![]() Liens
Liens
![]() BLOG
BLOG
![]() PLAN
PLAN